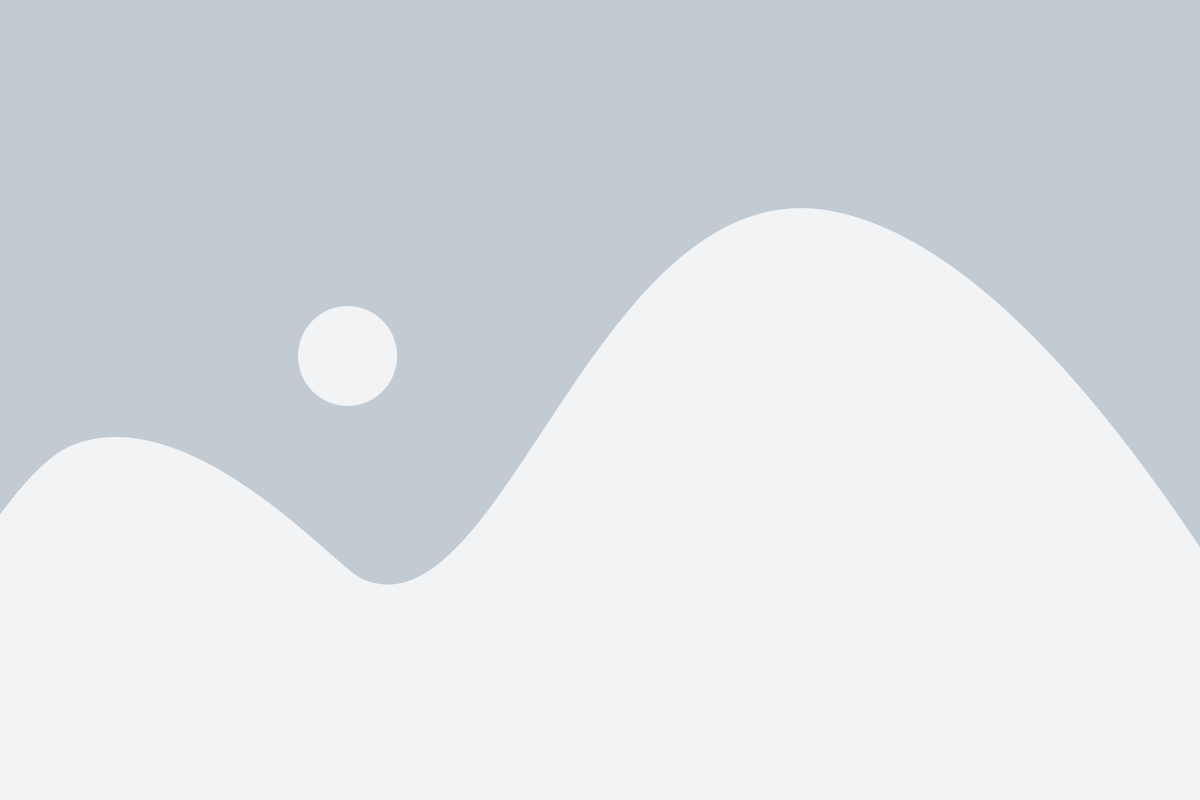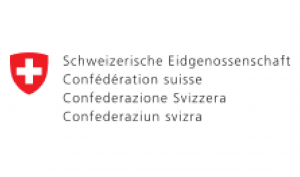L’eau est présente en abondance et en qualité dans l’agglomération transfrontalière. Elle contribue à une nature riche et variée en structurant les paysages par de vastes espaces ouverts, par la ripisylve et les zones humides. Au sein d’un territoire en croissance, elle offre également des espaces de délassement précieux, largement prisés par la population.
L’eau construit des liens permanents entre la France et la Suisse, depuis les têtes de bassin en direction du centre de la cuvette. Le vaste réseau hydrographique structure le territoire, reliant la campagne et la ville, le cœur d’agglomération et le réseau des bourgs et des villages. Ressource naturelle majeure du Grand Genève, l’eau est à la base de collaborations transfrontalières robustes auxquelles les acteurs du territoire sont attachés.
Comme l’air ou le sol, l’eau représente un atout majeur du territoire, autant qu’un élément central de sa transition écologique. Les menaces sur la ressource et les milieux aquatiques sont liées au changement climatique et à l’évolution des besoins du territoire, faisant peser sur les acteurs du territoire une responsabilité accrue dans plusieurs domaines :
- gestion quantitative de la ressource ;
- garantie des débits minimums biologiques ;
- protection contre les inondations ;
- préservation durable des espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Stimuler des collaborations innovantes entre France et Suisse
Si l’existence d’une frontière nationale constitue inévitablement un élément de complexité supplémentaire, elle peut aussi contribuer à stimuler des collaborations innovantes entre France et Suisse. C’est notamment le cas dans le domaine de l’eau où les outils, tour à tour suisses ou français, sont partagés et mutualisés :
-
Outil français à l’origine, les contrats de rivières ont été largement déployés au niveau transfrontalier durant la première décennie 2000. Ces dispositifs ont ensuite évolué vers les contrats globaux environnementaux, les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ou les contrats de territoire, intégrant à chaque fois une composante transfrontalière qui s’étend parfois au-delà du seul périmètre du Grand Genève.
Renforcer la gestion intégrée des ressources en eau stratégiques
La gestion des ressources en eau potable constitue un sujet de plus en plus stratégique sur le plan transfrontalier en regard du partage naturel des ressources et de l’évolution des usages face aux transitions démographique et climatique.
- Convention de gestion de la nappe du Genevois : Initié en 1978 pour enrayer le processus d’abaissement critique de la nappe grâce à une exploitation coordonnée et un dispositif de réalimentation, le partenariat transfrontalier a été renouvelé en 2008 puis actualisé en 2025 pour mieux intégrer les enjeux climatiques, démographiques et financiers. https://www.ge.ch/document/39351/telecharger
- Planification transfrontalière de la ressource en eau potable : Dans le respect des compétences de chacun, l’amélioration de la gestion des ressources, la sécurisation des approvisionnements et la gestion de crise passe par un renforcement des coopérations transfrontalières sur une base volontaire. Plusieurs démarches sont en cours.
Conserver l’avance du territoire et intégrer les problématiques émergentes
Face aux problématiques émergentes, les acteurs du territoire sont en mesure de partager leur expertise et développer des partenariats innovants tels que la mutualisation du traitement des micropolluants entre les stations de Villette (Genève-Thonex) et Ocybèle (Annemasse agglo).